Elle est née en Allemagne il y a un siècle tout juste. Aussi en entend-on beaucoup parler ces jours-ci. Deux petits commentaires.
J'aime: sa réflexion sur la "banalité du mal". Lors de la publication de ses chroniques sur le procès d'Adolf Eichmann (à Jérusalem en 1961), elle était en conflit avec une grande partie de la presse israëlienne. Pour de bonnes raisons, il me semble. Elle a juste remarqué ce que la ligne de défense d'Eichmann ("j'ai suivi les ordres")impliquait: celui qui fut nommé "administrateur du transport" lors de la conférence de Wannsee (janvier 1942), c'est-à-dire celui qui fut chargé de mettre en place la "solution finale", n'était ni un fou ni un "monstre" mais un homme ayant décidé d'obéir jusqu'au bout. Les gens comme lui étaient "effroyablement normaux". Dans son témoignage sur Auschwitz, Primo Levi a écrit : "Ils étaient faits de la même étoffe que nous, c’étaient des êtres humains moyens, moyennement intelligents, d’une méchanceté moyenne : sauf exception, ce n’étaient pas des monstres, ils avaient notre visage".
En revanche, je n'aime pas: l'idée (fausse) selon laquelle le stalinisme et le nazisme sont l'expression d'un même mouvement de destruction, le "totalitarisme". Il faut étudier et critiquer chacun de ces deux systèmes plutôt que de tenter de les rapprocher à tout prix. Arendt tente de théoriser les ressemblances au niveau de la propagande (utilisation de la terreur et du mensonge), de l'organisation ("l'Etat total") et de la police secrète. Il existe des points communes. Mais cette comparaison, bien que nettement supérieure aux âneries de Stéphane Courtois, amène Arendt à commettre plusieurs erreurs. Elle affirme "utiliser le mot totalitaire avec parcimonie et prudence". Mais la méthode demeure abusive.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

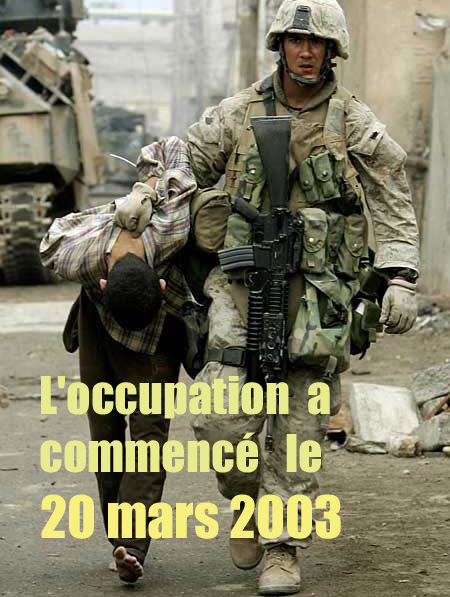
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire